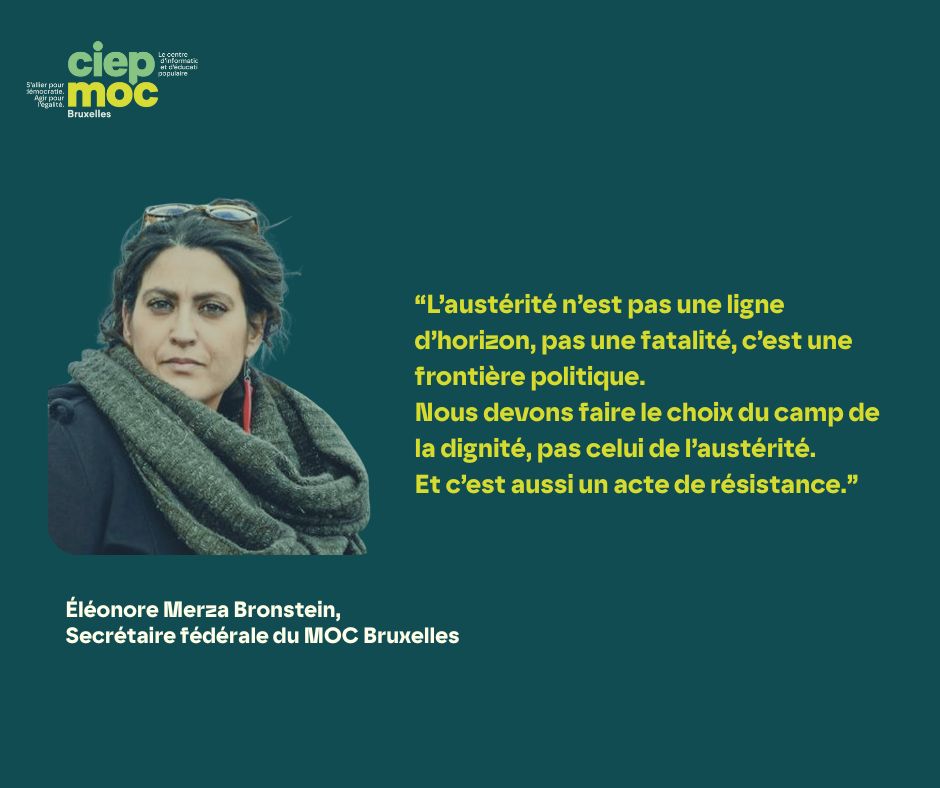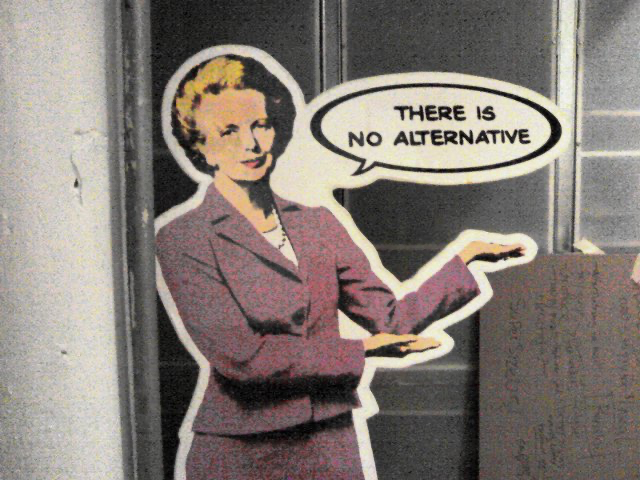François Sana
Responsable des matières environnementales CSC
D’après les derniers chiffres dont nous disposons, la Belgique a réduit ses émissions totales de gaz à effet de serre (GES) de 21,9% en 2017 par rapport à l’année de référence 1990. Ce n’est pas si mal mais il faut accélérer les efforts si l’on veut se préserver d’un réchauffement climatique potentiellement catastrophique. Les secteurs principaux responsables des émissions de GES sont bien connus. Il s’agit, pour notre pays, de l’industrie (46,6%), des transports (22,5%), du bâtiment (18,1%) et de l’agriculture (10,8%). Si tous ces secteurs réduisent leurs émissions depuis de nombreuses années, il en est deux qui continuent à les augmenter : le secteur des transports et celui du chauffage résidentiel.
Nous savons donc sur quoi travailler pour limiter le changement climatique. Première bonne nouvelle : nous disposons déjà des pratiques et technologies efficaces d’un point de vue écologique. Deuxième bonne nouvelle : la transformation des quatre secteurs mentionnés ci-dessus sera créatrice nette d’emploi et engendrera d’autres retombées positives pour la société dans son ensemble. Voyons cela plus en détail.
En ce qui concerne l’industrie, l’économie circulaire sera amenée à jouer un rôle de plus en plus important. De quoi s’agit-il ? De concevoir les nouveaux produits de façon écologique, dès le début de leur cycle de production. L’écoconception permet de créer de nouveaux biens en pensant à leur réparabilité et à leur réutilisation dans le processus industriel. Le principe d’économie circulaire permet ainsi de réduire les impacts environnementaux et de limiter au maximum le gaspillage de ressources naturelles. Différentes études montrent un potentiel de création de millions d’emplois dans l’économie circulaire à travers l’Europe. Mais il faudrait aller encore plus loin. Les auteurs du best-seller « cradle to cradle » proposent désormais un nouveau concept : l’upcycling. Il s’agit d’après eux non pas de réduire notre impact sur la Planète mais de viser bien plus haut : régénérer notre Terre et l’améliorer à travers les processus industriels. Un exemple concret : Strasbourg vient d’inaugurer la première tour d’habitation qui produit plus d’énergie (renouvelable) qu’elle n’en consomme. Les principes de l’upcycling devraient se généraliser à tous les processus industriels. Ainsi, l’eau ressortirait plus propre des usines, de l’énergie renouvelable serait créée, la qualité des sols s’améliorerait plutôt que de se dégrader, etc.
Deuxièmement : les transports. En Belgique (et ailleurs) il est urgent de mettre fin à l’étalement urbain et de recentrer les activités et services (économiques, culturels, sociaux, …) dans les centres-villes. Il faut éviter la dépendance à la voiture pour tous nos gestes quotidiens et au contraire, évoluer vers des villes d’où les voitures seraient presque totalement absentes. Cela aurait le double avantage d’améliorer la qualité de l’air et la santé des habitants de notre pays. Nous avions en Belgique un réseau ferroviaire très dense. La priorité donnée à la bagnole, la fermeture de nombreuses gares et lignes de chemins de fer depuis des décennies ont fait que de nos jours, il est presque impossible de se passer de voiture pour nombre de nos concitoyens. Avant de penser à les taxer il faudrait mettre en place des alternatives. Des alternatives peu couteuses (voire gratuites), sûres, efficaces et ponctuelles. Cela ne se fera pas sans réinvestir dans les transports en communs. A ce sujet, le Grand-Duché du Luxembourg nous montre la voie à suivre. Il a en effet décidé de rendre tous les transports publics gratuits dès le premier mars 2020. Le coût additionnel de la gratuité des trains ? 40 millions d’euros annuels. Ce montant est celui des recettes de la vente des tickets et abonnements, recettes qui ne seront évidemment plus là lorsque les trains seront gratuits. Sur une population d’environ 500.000 habitants, cela fait un coût de 80 euros annuels par habitants. Cela donne à réfléchir. Il est à noter que la première classe restera payante. Par ailleurs, la Confédération Européennes des Syndicats a montré les effets d’un scénario au niveau européen dans lequel les transports en commun seraient favorisés par rapport à la voiture individuelle : une baisse des émissions de GES du secteur des transports de 30% à l’horizon 2020, des pertes d’emploi dans la construction de voitures s’élevant à 4,5 millions mais une création de 8 millions d’emplois dans les transports en communs.
Troisième secteur à changer : le bâtiment. Il conviendrait d’accélérer sensiblement le rythme annuel des rénovations énergétiques pour respecter nos engagements dans le cadre de l’Accord de Paris. En clair, en Belgique, nous rénovons à un taux annuel de 0,5%. Nous devons atteindre un taux de 3% par an dès 2020 jusqu’à 2050 afin d’honorer ces engagements. La rénovation énergétique des bâtiments est un chantier énorme qui s’ouvre devant toute politique écologique sérieuse. Avec des objectifs ambitieux et stables affichés, on peut lancer les filières qualifiantes en utilisation de matériaux écologiques et rénovation énergétique des bâtiments, créer des milliers d’emplois non délocalisables sur notre territoire, réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre, diminuer les inégalités et améliorer l’état de santé de nos concitoyens. Rien que ça. Comment ? Par exemple, en engageant un programme d’isolation de tous les logements sociaux, en accompagnant les personnes les plus défavorisées dans la rénovation, et en priorisant les primes sur les bâtiments dotés d’une PEB F ou G (46% des logements wallons).
Reste l’agriculture. Il est temps de sortir de l’agriculture industrielle, destructrice des sols et polluante, et de développer une agriculture de plus petite taille, sans pesticides ou autres intrants chimiques, basée sur le respect de la terre et les circuits courts. Ce type d’agriculture, non seulement peut piéger le carbone dans le sol, mais il a été aussi démontré que l’agro-écologie pourrait nourrir une planète peuplée de 10 milliards d’habitants. De plus, une agriculture de ce type produit des aliments sains et contribue ainsi à améliorer l’état général de santé des gens. Elle est aussi plus intensive en travail que l’agriculture industrielle et de nombreux jeunes demandent à être soutenus pour réaliser des projets en agriculture biologique, permaculture ou encore agroécologie.
Résumons-nous. Les quatre secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre pourraient être rapidement et radicalement transformés. Cela aurait de multiples avantages, notamment en matière de création d’emplois et d’amélioration de la santé de la population. Une récente étude européenne indique par ailleurs que la Belgique serait le pays européen qui bénéficierait le plus, en création d’emplois, de la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Qu’attendons-nous donc pour agir ?
Il reste un problème : le coût. Comment financerait-on ces différents chantiers ? Indiquons brièvement quatre pistes de solutions. La Banque centrale européenne a racheté pour plus de 2.500 milliards d’euros d’obligations d’Etat et d’actions d’entreprise pour relancer l’économie depuis 2014. Force est de constater que cela n’a pas fonctionné. Une ONG néerlandaise a montré que l’essentiel de ces rachats d’actions et obligations (« quantitative easing », dans le jargon des économistes) est allé financer les entreprises les plus polluantes telles que Shell, Total, Ryanair, Lufthansa, BMW, Volkswagen, etc. D’où l’idée de plusieurs économistes de flécher ce quantitative easing, c’est-à-dire de l’orienter vers des projets écologiques compatibles avec le respect de l’Accord de Paris.
Une autre idée circule, celle de créer une banque européenne pour le climat. Elle pourrait être une filiale de la Banque Européenne d’Investissement comme le propose notamment l’économiste français Pierre Larrouturou. Son mandat ? Allouer à chaque Etat signataire d’un pacte finance-climat l’équivalent de 2% de son PIB chaque année pour financer la transition écologique.
Il conviendrait aussi de relancer l’investissement public dans les secteurs porteurs de cette transition écologique. A ce titre, il devient urgent d’assouplir voire de mettre fin aux règles européennes qui contraignent les Etats-membres de l’UE à comptabiliser l’entièreté de leurs investissements publics l’année où ceux-ci sont réalisés. Les entreprises et les ménages peuvent bien amortir sur plusieurs années leurs investissements, il n’y a aucune raison pour que les Etats ne soient pas autorisés à en faire de même particulièrement en ce qui concerne les investissements dans la transition écologique, générateurs d’emplois et de bien-être.
Enfin, un mouvement d’une ampleur internationale se développe depuis 2010 : le « divestment » ou désinvestissement fossile. Il a émergé au sein des campus des universités américaines. Il s’agit de sortir les investissements des banques, fonds de pensions, etc. dans les énergies fossiles. L’argent récupéré de la revente d’actions d’entreprises liées aux combustibles fossiles pourrait servir lui aussi à financer la transition.
On le voit, les pistes et les actions concrètes à réaliser ne manquent pas. Elles permettent de dépasser le clivage emploi/environnement. Plus que de longs débats, il est urgent maintenant d’unir les différentes luttes sociales et écologiques et d’imposer, par la rue, la mise en œuvre d’une véritable politique climatique.