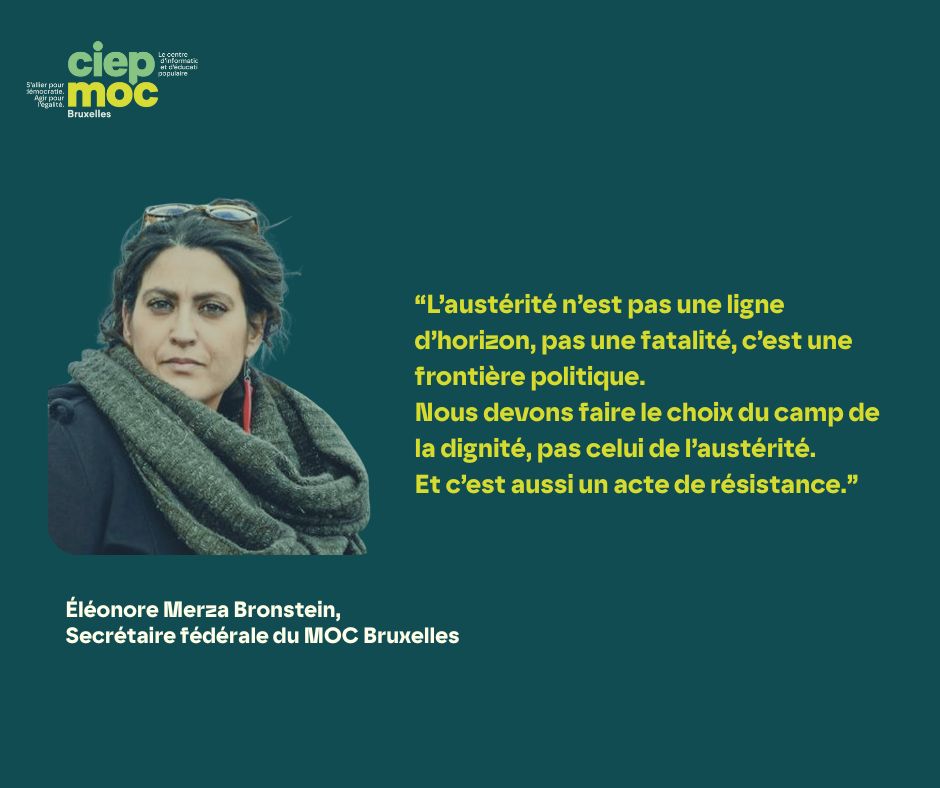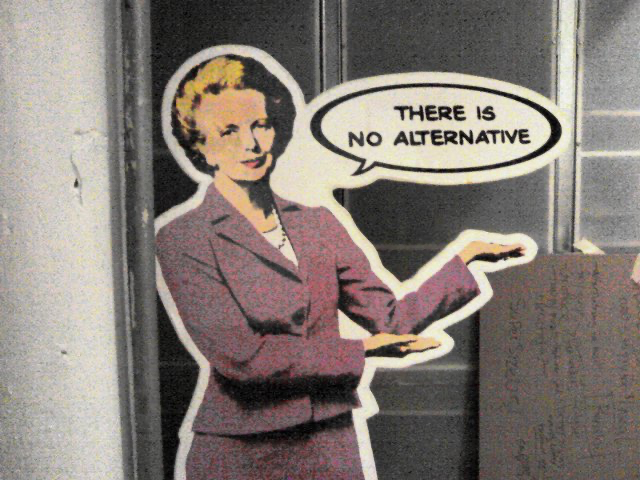Par Benjamin Peeters,
CEREC (Centre de recherche en économie),
Université Saint-Louis de Bruxelles
La crise du Covid a bouleversé nos sociétés. De nombreuses personnes ont perdu des proches. Beaucoup ont été assigné.e.s à résidence. Les prix des maisons, à l’instar des dettes des pays, ont grimpé. Quasiment partout des écoles ont été fermées. Les taux de chômage ont décollé. Plusieurs pays émergents ont vu leurs monnaies s’effondrer.[1] Les approvisionnements internationaux ont été fortement perturbés. Les prix de certaines matières premières ont connu de forte fluctuations. Les relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis se sont encore dégradées. Les banques centrales ont inondé les marchés financiers de liquidité. Les prix des actions ont dégringolé pour ensuite atteindre des niveaux bien supérieurs à leurs niveaux d’avant-crise, notamment pour les entreprises états-uniennes.[2] Parallèlement, l’administration américaine (notamment le président et congrès) a changé, les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, les effets du dérèglement climatiques se sont accrus, une guerre civile a débuté en Éthiopie, etc. Ces éléments peuvent amener à voir la crise actuelle comme une rupture majeure dans l’évolution des rapports de production et de l’économie mondiale. Un peu plus d’un an et demi après la déclaration en Mars 2020 par l’OMS de la pandémie, cet article propose de prendre du recul par rapport à ces disruptions et d’analyser certaines tendances économiques majeures à l’échelle de l’économie mondiale.
Un commerce international toujours instable
Le processus d’internationalisation des échanges a récemment été déstabilisé par deux phénomènes : l’ébranlement des chaînes d’approvisionnement causé par la pandémie et l’accroissement de la conflictualité entre la Chine et les États-Unis. Les multiples pics de contamination, les assignations à résidence, les fermetures temporaires de ports internationaux ou d’entreprises d’assemblage ont ralenti voire arrêté temporairement le flux de matières premières et de produits finis et semi-finis, perturbant de nombreux réseaux internationaux de production.[3] La conflictualité entre la Chine et les États-Unis s’est accrue, avec notamment plusieurs fractions de la classe dirigeante américaine faisant porter la responsabilité de l’épidémie sur la Chine, les tests militaires de la Chine et les tensions diplomatiques. Malgré cet accroissement des tensions, le commerce international a repris rapidement et les exportations mondiales de marchandises dépassent en avril 2021 les niveaux d’avant la pandémie.[4] Concernant la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, la situation n’est pas plus tendues qu’en 2018 où les tarifs douaniers avaient fortement augmenté.[5] La tendance des politiques relatives aux investissements étrangers n’est pas différente de celle de ces dix dernières années et globalement plus de politiques de libéralisation des échanges ont été signés en 2019 et 2020 que des politiques les restreignant.[6] Dans l’ensemble, la crise du coronavirus ne semble pas avoir bouleversé en profondeur les tendances du commerce international qui est avant tout caractérisé par des politiques libre-échangistes couplées avec la constitution de blocs régionaux et perturbé par les tensions sino-américaines.
Les États à la rescousse
Afin de contenir les retombées de la pandémie, les États ont renforcé leur influence. À cet égard, plusieurs idées reçues se sont répandues. Pour certain.e.s, la pandémie de COVID-19 aurait révélé les conséquences désastreuses des privatisations, déréglementations et externalisations et aurait mis un terme au « jeu néolibéral ». Le développement rapide des vaccins a également été vu comme annonciateur d’un retour de la planification et de la politique industrielle.[7] Certes, les gouvernements ont en effet dépensé des milliards de dollars en soins de santé, vaccins, chômage et aide aux entreprises. Les banques centrales ont massivement imprimé de l’argent pour financer des déficits budgétaires qui explosent, amenant ce faisant les taux d’intérêt à des valeurs très faibles.[8] De nombreuses banques ont même été contraintes sur les versements de leurs dividendes ! Pour la première fois depuis des décennies, la direction des déplacements de l’imposition des sociétés est à la hausse plutôt qu’à la baisse.[9] Néanmoins, bien que ces éléments soient marquants, ils symbolisent davantage une accélération des tendances pré-COVID plutôt que des changements de tendances. En effet, la mise en œuvre du couple « déficits publics et impressions monétaires » a surtout été une remise à l’actualité des « remèdes » utilisés pour faire face à la crise financière de 2007-2012 (avec une ampleur plus importante), dans la lignée des tendances antérieures.[10] Notons également que, jusqu’à présent du moins, les dépenses réelles des gouvernements ont quasi-systématiquement été moindres que celles annoncées et que la quasi-totalité des budgets dépensés l’a été sous forme de transferts au secteur privé plutôt que d’investissements publics. L’objet des politiques des États a surtout été de « contenir les effets négatifs d’un choc exogène sur les secteurs privés, la grande majorité étant « purement conjoncturelle ». Concernant les taxes et les politiques industrielles, il est notable que les orientations soient surtout le fruit d’une volonté des grandes puissances industrielles de trouver des sources de financement, de garder la mainmise sur les technologies-clés dans un environnement international de plus en plus compétitif ou pour des motifs géopolitiques (c’est le cas des semi-conducteurs par exemple). Même si les perturbations des chaînes d’approvisionnement et la hausse des dettes publiques liées au coronavirus jouent un rôle-clé dans les politiques industrielles et fiscales, nombreux de ces éléments étaient déjà à l’agenda des politiques publiques avant la pandémie.[11]
Endettement et fragilité générale
La crise déclenchée par la pandémie a massivement accentué les fragilités financières. La hausse de l’endettement des États, des entreprises privées et des ménages ainsi que des bilans des banques centrales a accru les risques de défaillance et de contagion dans le système financier. La faiblesse des taux d’intérêt qui découle des politiques des banques centrales a en effet augmenté les possibilités d’endettement. Ces politiques ont également fortement diminué l’attractivité financière des obligations souveraines et orienté les capitaux vers les actions dont les valorisations sont démesurément élevées par rapport aux tendances historiques et aux revenus (surtout aux États-Unis). En outre, les aides financières aux entreprises ont entraîné de très faibles taux de faillites durant la crise présageant l’existence de nombreuses entreprises « zombies » dont la profitabilité et la solvabilité sont douteuses. La hausse de l’endettement des ménages et des prix de l’immobilier sont aussi des facteurs classiques de fragilité.[12] Dans ce contexte, la remontée de l’inflation et la volonté des banques centrales à la stopper (déjà annoncée dans de nombreuses économies) pourraient entrer en conflit avec la reprise économique, mais aussi avec les capacités de remboursement des États (et en particulier les pays pauvres) et des entreprises. Vu la hausse de l’endettement des entreprises et les très faibles taux de faillites, la fin des aides financières pourrait amorcer une hausse des faillites d’entreprises (une « correction » puis à retour à la tendance) et une dévalorisation abrupte des actions. Ces deux phénomènes pourraient compresser les bilans des entreprises et des banques, et induire de gros risques macroéconomiques. Les risques systémiques relevés ici sont pour la grande majorité dans la continuité des tendances de la dernière décennie et ne furent qu’accélérés par la pandémie. Ceci est notamment le cas pour l’endettement public et des entreprises, la hausse du prix de l’immobilier, le développement des innovations financières et la forte valorisation des actions états-uniennes.
Le changement dans la continuité
Au moins trois autres continuités doivent être mentionnées afin de fournir une vue d’ensemble.[13] Premièrement, les économies du centre conservent un contrôle immense sur les chaînes de production. Cela peut notamment s’observer par la répartition inégale des vaccins dans le monde.[14] Seulement quelques industries des pays occidentaux du centre (Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, et AstraZeneca), ainsi que Sinovac (Chine), se partagent le gâteau en terme de revenus mondiaux des vaccins. Un autre exemple concerne la récente signature par 136 pays pour imposer une taxation minimale à 15% sur les multinationales. Ce projet est certainement une avancée sur certains aspects. Néanmoins, il met également au jour la capacité des pays riches à imposer que les bénéfices taxés reviendront là où les sièges sociaux sont localisés, c’est-à-dire chez eux, et non là où la production réelle est effectuée.
Deuxièmement, une autre continuité majeure de la période, qui n’a globalement pas été très affectée par la pandémie, est l’absence de mouvements de masse de travailleurs.[15] Deux mobilisations ont été notable en Occident depuis la crise. Le mouvement Black Lives Matter et les manifestations contre les mesures contraignantes lié à la vaccination (par exemple, récemment suite aux passes sanitaires). Notons que le premier mouvement n’est pas directement lié à la pandémie et que les deux n’ont pas eux d’impacts majeurs en terme de changements politiques.[16] Plus fondamentalement, il ne s’agit pas de mobilisations sur le terrain des travailleurs, sur les lieux de travail. Autre tendance, les syndicats institués ont été globalement incapables de défendre les intérêts des travailleurs durant la période.
Troisièmement, les gouvernants se sont illustrés dans leurs faibles capacités à gérer les défis auxquels l’humanité doit faire face. L’ex-président des États-Unis a été jusqu’à suggérer de s’injecter du désinfectant comme traitement. La Chine a refusé pendant des mois de permettre une investigation sur les origines de la pandémie, empêchant toute compréhension claire que ce qui s’était passé. L’administration britannique a pendant longtemps prêché une immunité collective afin de continuer à faire tourner les usines dans l’objectif d’amasser des profits pendant que les concurrents étaient à l’arrêt, et ce contre l’avis de la grande majorité de la communauté scientifique. Les administrations belges ont réussi la prouesse d’imposer trois couvre-feux différents entre Wavre et Bruxelles (c’est-à-dire un trajet d’environ 25 km). L’ouverture et la fermeture chaotique des frontières l’hiver dernier a été également l’occasion d’exposer les manques de planification et des capacités de gestion. Plus généralement, la mainmise de la propriété privée empêche une vaccination massive de toute la planète et favorise le développement de nouveaux variants. La règle – nécessaire dans un environnement international composés de bourgeoisies et bureaucraties en compétition – a davantage été une absence de coopération et une volonté de maintenir la production des grandes entreprises, malgré la nécessité de faire face à une problématique collective à l’échelle de l’humanité et l’urgence sanitaire.[17]
La crise économique, sociale et sanitaire déclenchée par la pandémie a bouleversé les conditions de vie des populations ainsi que les finances et le rôle des États. Néanmoins, malgré ces transformations, la crise du coronavirus semble davantage avoir accéléré les tendances antérieures des rapports économiques fondamentaux plutôt qu’être un point de bifurcation. L’état de l’économie mondiale semble surtout être le produit de la mainmise des bourgeoisies et bureaucraties des grandes économies sur les moyens de production, l’instabilité de la finance et l’accroissement généralisé de l’endettement, la confrontation entre la Chine et les États-Unis, le déclin économique relatif de l’Occident, et la faiblesse des mobilisations et organisations des travailleur.se.s.
Sources principales
– Trade and Development Report 2021, UNCTAD
https://unctad.org/webflyer/trade-and-development-report-2021
– World Investment Report 2021, UNCTAD
https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2021
– World Economic Outlook, IMF, octobre 2021
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
– FSB annual report, 2021. Financial Stability Board (FSB), octobre 2021
https://www.fsb.org/2021/10/2021-fsb-annual-report/
– Le dernier rapport de l’OMC sur les mesures commerciales du G20 du 28 octobre 2021
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/report_trdev_nov21_e.pdf
– Articles du Financial Times et du Peterson Institute For International Economics
[1]Par exemple, entre Janvier et Juillet 2020, relativement au dollar américain, la monnaie brésilienne a perdu 23 %. Sur la même base, en Afrique du Sud, en Russie, au Mexique et en Turquie les monnaies se sont dépréciées d’environ 18 %, 17 %, 15 % et 15 % respectivement.
[2]À titre illustratif, le Nasdaq (un indice boursier américain mesurant la performance des actions d’entreprises « technologiques ») a perdu un peu plus de 20 % début janvier suite à la pandémie et a ensuite plus de doublé (prenant des valeurs plus de 50 % plus élevées par rapport aux valorisations boursières du pic d’avant-crise).
[3]À cela s’ajoutent d’autres phénomènes, comme par exemple le blocage du canal de Suez en fin mars 2021 ou la récente sécheresse au Brésil amenant à une hausse des importations de gaz participant à la hausse générale du prix de la ressource.
[4]Cette croissance est principalement tirée par l’Asie. Les pays « avancés » ont retrouvé des niveaux d’exportations comparables à 2019. Seuls les pays pauvres, notamment en Afrique, continuent à avoir des exportations plus faibles.
[5]La situation s’est calmée suite à la signature d’un accord de hausse des importations des produits américains par la Chine en janvier 2020. La situation n’a pas beaucoup changé depuis. La différence majeure dans les politiques a été la volonté de rapatrier des unités de production stratégique, en premier lieux des usines de semi-conducteurs. Cette tendance s’est accrue avec la crise et les perturbations des chaînes d’approvisionnement mais est également en phase avec la tendance d’avant la crise.
[6]Néanmoins, le nombre de politiques restreignant les investissements étrangers a augmenté cette dernière décennie.
[7]Par exemple, bien que Boris Johnson ait attribué ce succès au « capitalisme », 97 % du financement pour le développement du vaccin Oxford/AstraZeneca provenait de l’État ou de fondations caritatives, tandis que moins de 2 % provenaient de l’industrie privée. Dans la même veine, un rapport indépendant examinant les leçons de l’expérience vaccinale du Royaume-Uni établit que « le gouvernement a joué un rôle clé dans l’accélération de chaque étape du processus de développement d’un vaccin ».
[8]Au niveau mondial, le ratio de la taille du bilan des banques centrales sur le PIB a quasiment doublé (environ 35 % du PIB début 2019 et 60 % aujourd’hui) et les dettes (déclarées et enregistrées) des États relativement au PIB ont augmenté de 20% (environ 75 % début 2019 et 90 % en aujourd’hui). Évidemment, de grandes disparités existent entre pays.
[9]L’influence de l’État s’est aussi accrue au regard des processus de surveillance des populations. En effet, plusieurs applications destinées à traquer les expositions au coronavirus, gérées par les gouvernements, ont soulevé des problèmes de surveillance et de confidentialité. Les assignations à domicile, l’utilisation de passeports vaccinaux, et les restrictions sur les déplacements, les couvre-feux, sont d’autres signes d’une montée autoritaire de l’État. Même s’il est incontestable que ces éléments sont des changements majeurs, il est également important de noter qu’avant le coronavirus les inquiétudes concernant les grandes technologies, le capitalisme de surveillance et les attaques sur les droits des mobilisations des travailleur.se.s montaient.
[10]Notamment, celles-ci sont caractérisé par les hausses relativement généralisées au niveau mondial des bilans des banques centrales sur la période fin 2008-2018 et des endettements publics durant toute la décennie avant la pandémie – surtout entre 2007 et 2013 pour les pays riches et entre 2012 et 2019 pour les pays pauvres.
[11]Par exemple, le projet de taxe sur les GAFAM poussées par la France avant la pandémie – « gelée » depuis les négociations d’une taxe mondiale par le G20 – ou la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis commencée en 2018.
[12]Trois facteurs additionnels majeures qui accentue l’instabilité financière doivent être ajouté : (i) l’intermédiation par des acteurs non-bancaires s’accroît constamment, et donc la dépendance à une plus grande liquidité des marchés financiers (et notamment le prix des actions) ; (ii) de nouveaux produits financiers se développent cryptomonnaies, service digital, etc.) et (iii) l’endettement des pays « émergents et frontières » en « monnaies fortes » est très important
[13]Pour des raisons de concision, ces éléments sont seulement développement de manière très lapidaire.
[14]Le dernier rapport sur l’économie mondiale du FMI (World Economic Outlook, Oct. 2021) indique que, en moyenne, environ 70 % de la population des économies « avancées » ont reçu au moins une dose, contre environ 50 % pour les « émergents » et moins de 10 % pour « pays en développement à faible revenu ».
[15]Des mobilisations sociales plus locales ont été néanmoins significatives. C’est le cas notamment en Inde (avec les fortes mobilisations sociales de la paysannerie), en Biélorussie (suite à la réélection du président), au Liban (avant et depuis la crise sanitaire), en Birmanie (suite au coup de la Junte militaire) et les grèves du secteur pétrolier en Iran.
[16]Par exemple, l’évolution du nombre de personnes noires tuées au États-Unis n’a pas été affectée par ces mobilisations. Précisons qu’il ne s’agit pas ici de discuter l’impact politique à long-terme de ces mouvements.
[17]La problématique climatique ne fait d’ailleurs pas exception lorsque l’on regarde les évolutions des émissions de ces dix dernières années, les dépenses en politiques climatiques ou les revenues des taxes carbones au niveau mondiale. L’hypocrisie de la classe dirigeante est d’ailleurs bien illustré par deux éléments d’actualité. Le premier est le vol privé du premier ministre britannique de Glasgow (là où a eu lieux la conférence internationale sur le climat) à Londres pour participer à un dîner, car il n’avait pas le temps de prendre le train. Le deuxième est la demande du président Biden à l’OPEP d’augmenter la production de pétrole pour faire baisser les prix alors qu’il cherche à réduire la produire domestique.