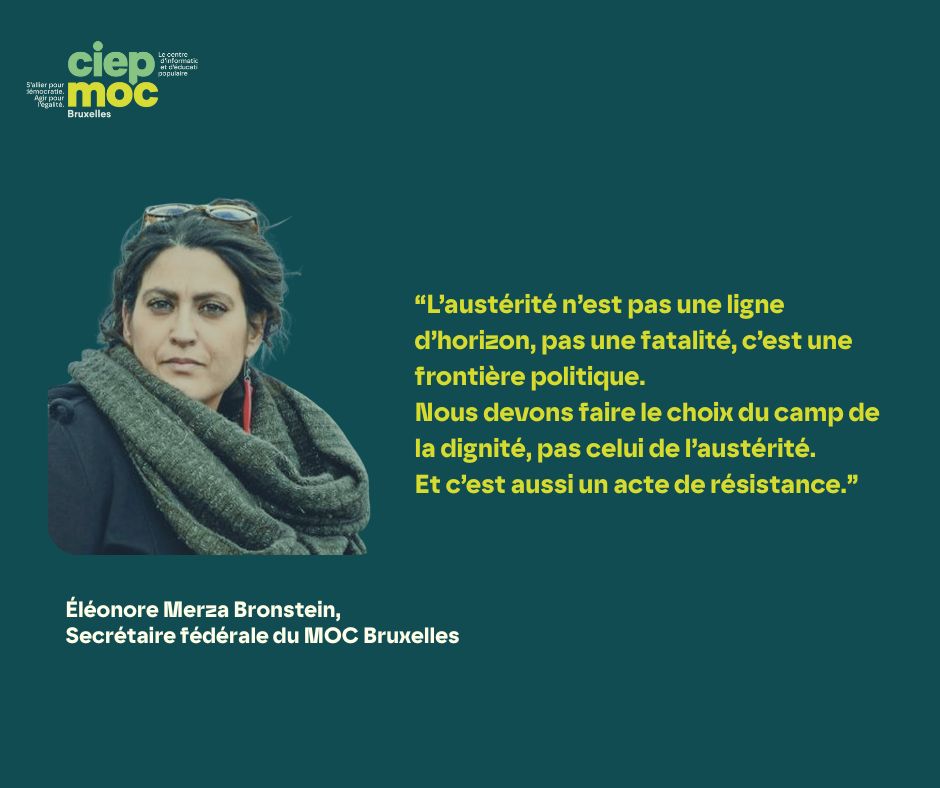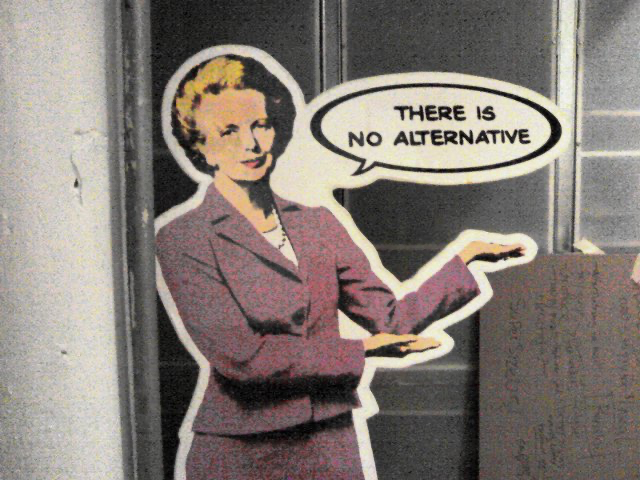Par Antonio Mota,
Doctorant en économie à l’Université de Campinas (Brésil)
Depuis les élections présidentielles de 2014, le Brésil traverse une profonde crise politique et économique. Le grand capital a rapidement exposé sa réponse à la crise. En octobre 2015, le programme « Un pont vers l’avenir » est publié, dans lequel la grande bourgeoisie situe l’excès de droits sociaux de la Constitution de 1988 comme l’origine de la crise fiscale de l’État et ajoute que pour retrouver la stabilité des comptes publics et de la croissance, il faut mettre fin à ces droits.
Avec ce programme, une guerre totale a été déclarée contre la classe travailleuse brésilienne. La déposition de Dilma Rousseff en août 2016 et la formation du gouvernement de Michel Temer ont représenté pour la bourgeoisie la possibilité politique d’exécuter les contre-réformes exigées par les hommes d’affaires. Le nouveau gouvernement a rapidement envoyé au Parlement des projets de loi qui ont profondément modifié les droits des travailleur.se.s, établis au Brésil depuis les années 1940. Le principal changement juridique a été la réforme du travail, approuvée par la loi 13.467 du 13 juillet 2017. En plus d’introduire de nouvelles formes d’embauche hyper-précaires, la réforme a détruit certaines garanties de sécurité de l’emploi (par exemple, l’exigence que les femmes allaitantes ne puissent pas exercer de profession à risque) et a également profondément modifié la législation sur les syndicats.
Les principaux changements ont porté sur le mode de financement des syndicats. Depuis l’instauration du droit du travail, les travailleur.se.s payaient une taxe syndicale qui était perçue par le gouvernement fédéral et reversée aux syndicats. Pendant des années, la taxe syndicale a été critiquée par la gauche, qui y voyait un moyen de modérer l’action des syndicats et de les soumettre à l’ingérence de l’État par le biais de transferts financiers, qui sont devenus une source importante de revenus pour les organisations et leurs bureaucraties. On estime, par exemple, qu’en 2017, quelque 106 000 personnes étaient employées directement par les syndicats et que les salaires de ces travailleur.se.s étaient principalement financés par les transferts fiscaux des syndicats.
Avec la réforme de 2017, la taxe syndicale a été supprimée. Les données de collecte des impôts des centrales syndicales permettent de comprendre l’impact concret de cette mesure : la Centrale unique des travailleurs (CUT), la plus grande centrale syndicale, liée au Parti des travailleurs, a perdu 94% de sa collecte d’impôts. Cela a poussé de nombreux syndicats à vendre leur siège et à licencier des employé.e.s.
Dans un contexte économique marqué par la récession et la hausse du chômage, les changements de législation ont eu deux impacts directs sur les syndicats. Premièrement, le taux de syndicalisation a rapidement diminué : en 2017, 19,5 % de la main-d’œuvre était syndiquée et en 2019, ce chiffre était de 11,2 %. Deuxièmement, le nombre de grèves a diminué : en 2017, il y a eu 1 566 grèves ; en 2018, 1 453 ; et en 2019, 1 119 grèves.
En s’attaquant aux organisations de la classe travailleuse, les gouvernements Temer et plus tard de Bolsonaro appliquent les mesures exigées par les grandes entreprises. En pleine crise sanitaire, le gouvernement a exempté les grandes entreprises de plusieurs taxes et a lancé une nouvelle réforme du travail qui permet de réduire les salaires horaires nominaux[1] des travailleur.se.s. La justification officielle est qu’en protégeant la rentabilité des entreprises, les emplois seraient également garantis. Ainsi, en mai, le revenu moyen des Brésilien.ne.s a baissé d’environ 18 %. Une partie importante des syndicats et des centrales syndicales ont demandé que l’exonération fiscale pour les grandes entreprises soit prolongée.
Bien que ces mesures aient été annoncées comme temporaires, les grandes entreprises agiront pour les pérenniser après la fin de la pandémie. Alors que le gouvernement se précipite pour augmenter la surexploitation de la classe travailleuse, le grand capital voit ses profits augmenter pendant l’épidémie actuelle. Au deuxième trimestre 2020, le profit de la plus grande banque brésilienne, Itaú, a augmenté de 7,5 % par rapport au premier trimestre : de 3,9 milliards de réais à 4,205 milliards de réais.
La crise sanitaire a été utilisée par l’extrême droite et le grand capital pour approfondir le néolibéralisme et sa lutte de classes “totale”, commencée en 2016. Affaiblis par la récession et les problèmes de financement, les syndicats ont agi pendant la crise sanitaire autour d’agendas défensifs. Utilisant des slogans pour défendre la vie des travailleur.se.s, les syndicats ont exigé que les entreprises fournissent gratuitement du matériel d’hygiène (masques et gel hydro-alcoolique) et ont demandé la suspension des activités, ce qui a souvent été accepté par les tribunaux, notamment dans le cas des écoles privées.
Un autre point défendu par le mouvement syndical est l’interdiction de licencier des salarié.e.s ou de restructurer des activités en période de crise sanitaire. Les deux plus grandes banques privées du pays (Bradesco et Itaú) ont entamé un processus de révision des objectifs pour une partie de leurs employé.e.s, qui a même entraîné la duplication des tâches à accomplir pour une partie de leurs employé.e.s. Les syndicats des banques ont entamé des actions pour interdire légalement cette politique.
Le pouvoir de résistance des syndicats a été fortement affecté, mais il continue de garantir des victoires à la classe travailleuse. Un exemple est le cas des salarié.e.s des métros de l’État de São Paulo, qui ont résisté aux plans du gouvernement de droite de l’État de São Paulo de réduire leurs salaires. Les travailleur.se.s du métro ont approuvé une grève reconductible, ce qui a poussé le gouvernement à renoncer à ses projets.
L’histoire du mouvement syndical brésilien se confond avec l’histoire récente du pays. A partir de la fin des années 1970, l’organisation de la classe ouvrière a été déterminante pour affronter la dictature militaire afin de garantir un processus de transition politique à caractère populaire. La création du Parti des travailleurs (PT) en 1980 est tributaire de cette réorganisation du syndicalisme. À partir des années 1990, avec l’avancée du néolibéralisme et l’acceptation d’une politique de gestion du capitalisme par le PT, la bureaucratisation a gagné de l’espace dans le syndicalisme brésilien.
Même ces syndicats bureaucratisés, qui ont eu la même direction pendant des années et qui sont passés par un long processus de modération politique, se sont avérés très dangereux pour le programme du grand capital. Pour maintenir les taux de profit, il était important de détruire tous les acquis légaux et institutionnels de la classe ouvrière, parmi lesquels les syndicats. Tout comme la résistance à la dictature à la fin des années 70 a été marquée par une réorganisation du syndicalisme, le mouvement syndical peut jouer un rôle important dans la résistance au gouvernement Bolsonaro.
Compte tenu de l’avancée de la précarité, une transformation des syndicats impliquerait nécessairement l’organisation du « précariat ». Les transformations productives des années 1990 et 2000 ont eu un impact sur l’ancienne forme de syndicalisme liée au prolétariat industriel. Organiser cette nouvelle classe ouvrière, c’est aussi réfléchir aux rapports entre les syndicats et les segmentations qui existent au sein de la classe travailleuse : femmes, Noir.e.s, immigré.e.s, etc. Le défi pour le mouvement syndical est donc énorme, mais la capacité de la classe travailleuse brésilienne à résister au néolibéralisme autoritaire dépend de cette réorganisation.
[1] Le salaire “nominal” peut augmenter par le simple effet de l’inflation, sans nécessairement augmenter le salaire “réel” et le pouvoir d’achat. Diminuer les salaires nominaux a donc un impact négatif encore plus important sur les salaires réels, quand on prend en compte l’inflation.