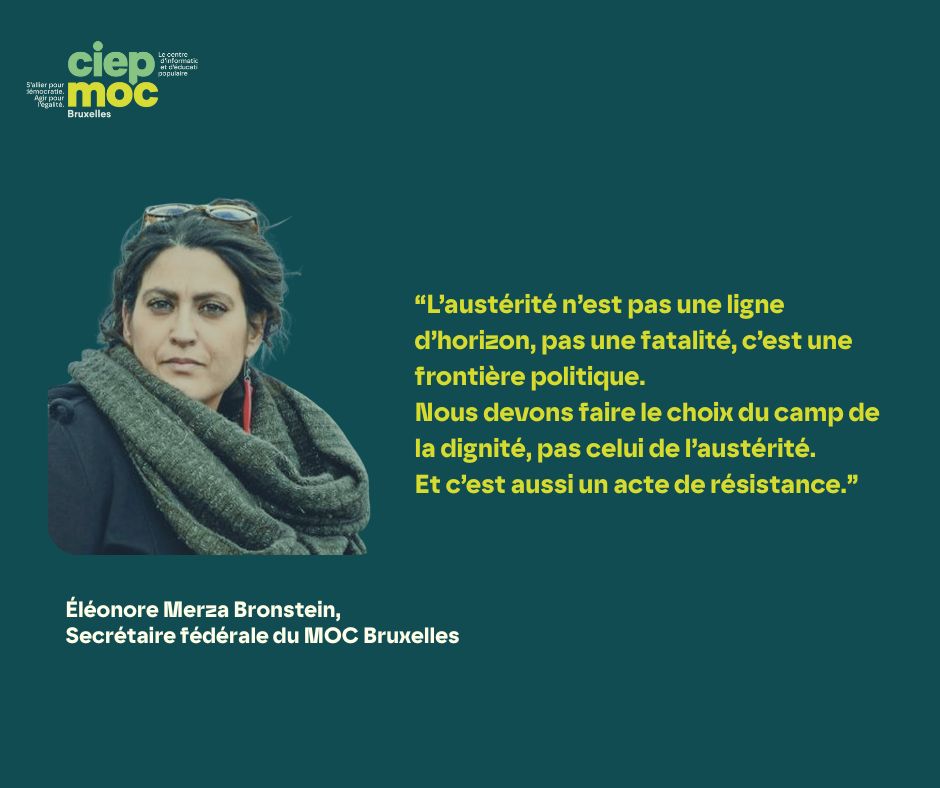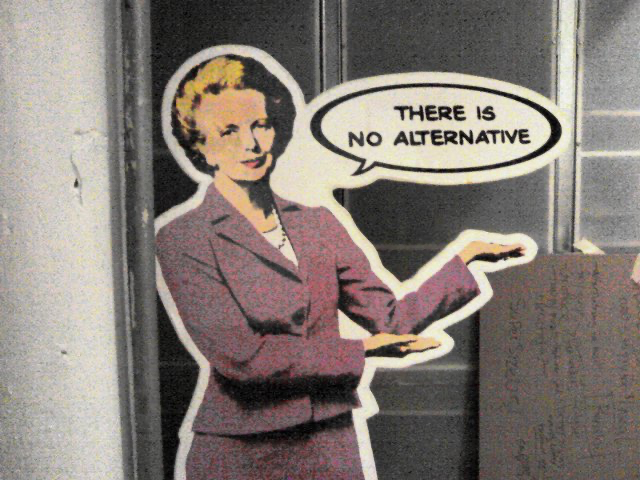Édito
Édito
Par Thomas Englert,
Secrétaire fédéral du MOC Bruxelles
« Nous avons un système socialiste pour les riches et le capitalisme sauvage pour les pauvres ». Ces mots de Martin Luther King Jr. illustrent bien notre situation actuelle. Nous connaissons tous les chiffres des inégalités, nous les vivons dans notre quotidien. Après 2008, ce sont les travailleur.euse.s, les chomeur.euse.s, les pensionné.e.s, les étudiant.e.s, les migrant.e.s et les jeunes qui ont payé les pertes des banques, des actionnaires et des spéculateur.trice.s. Les incendies au Brésil nous rappellent que la nature aussi fait les frais du capitalisme.
La mise en compétition à tous les niveaux complique les missions de nos organisations. La précarité de la vie et du travail pousse à l’individualisme et au repli sur soi. Ceux qui en profitent utilisent et alimentent le racisme et le sexisme. Dans un contexte où les problèmes semblent tellement énormes, il est souvent difficile de croire qu’à notre petit niveau on peut y changer quelque chose.
Pourtant, il y a toujours du monde qui se mobilise : les jeunes pour le climat, le mouvement féministe, les travailleur.euse.s sans papiers, Deliveroo, Ryanair, les pompiers, les blouses blanches, les collectifs de lutte contre les violences policières, les mobilisations contre l’Europe forteresse, les gilets jaunes,… impossible de citer tous les groupes qui s’organisent pour une vie meilleure, pour un revenu décent, le droit de tou.te.s à l’éducation, à la santé, à la mobilité, à l’égalité et à la justice. Lorsqu’on les écoute, ils ne disent pas que c’est facile ni que tout est parfait. Ils disent simplement qu’ils n’en peuvent plus et qu’il n’y a pas d’autre solution que de s’organiser pour mettre la pression. Et ils le font là où c’est possible, parfois à l’intérieur mais souvent à la marge ou à l’extérieur de nos organisations.
Dans ce numéro, nous avons voulu aller à la rencontre de quelques-un.e.s des acteur.trice.s de ces mobilisations et les écouter. Tou.te.s mettent en avant la proximité des luttes avec les réalités vécues et un contrôle plus direct sur les mobilisations grâce à des modes de décision et d’action qui permettent la participation du plus grand nombre… Ainsi que l’organisation de leur visibilité, notamment par l’utilisation des réseaux sociaux. Le collectif se construit simultanément dans le très concret du quotidien et en ligne. On retrouve aussi la recherche d’actions concrètes pour un rapport de force « jusqu’à ce que ça change ». Ce ne sont là que quelques éléments mais qui peuvent instruire notre construction de contre-pouvoirs.
La précarité signifie que la vie est rendue plus instable et changeante pour tou.te.s. Nous sommes un jour travailleur.euse.s, l’autre étudiant.e.s, sans-emploi ou malades. L’engagement devient donc plus instable aussi. Cette réalité est difficile à gérer pour nos organisations qui doivent s’adapter à ces caractéristiques structurelles de la période actuelle, alors que nos combats deviennent tous les jours plus urgents. La spécificité de l’approche du MOC, interprofessionnelle, basée sur tous les aspects de la « vie ouvrière », peut offrir un lieu de débat et d’expérimentation pour tenter de répondre simultanément à ces enjeux. C’est en remettant au centre de nos luttes, les expériences, la mobilisation et les conquêtes des marges que nous développerons les mouvements capables de remettre en cause les dominations capitalistes, racistes et sexistes sur tous les fronts.